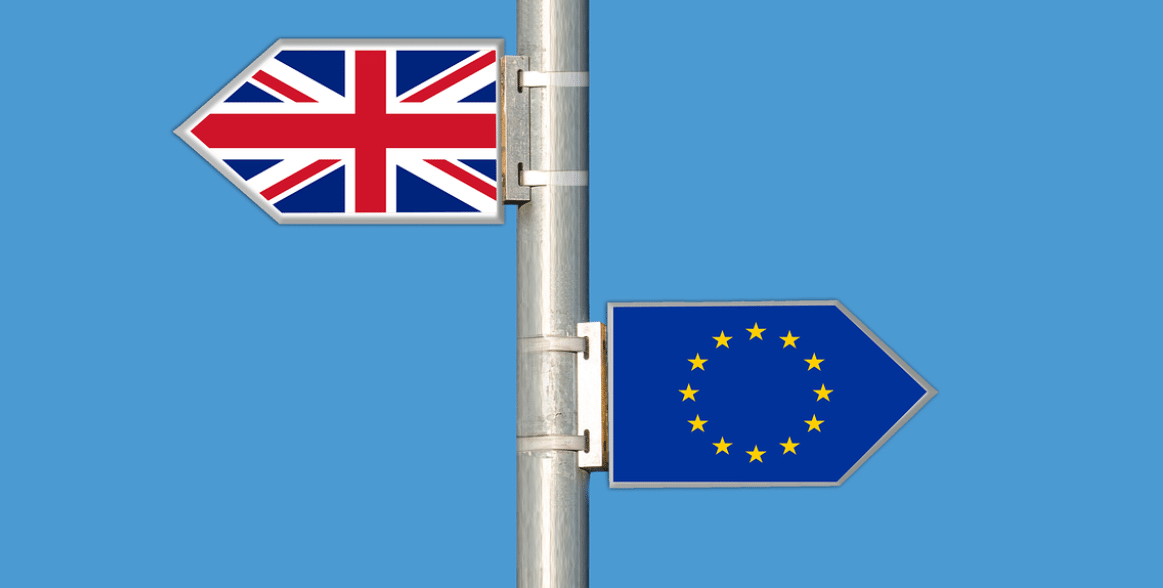L’équipe de l’ASFE s’est entretenue avec Michel Ruimy, Professeur à Sciences Po, sur l’état des négociations actuelles entre Londres et Bruxelles.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé lundi 7 décembre 2020 qu’aucun accord n’était encore trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur leurs relations post-Brexit. Qu’est-ce qui bloque ?
Deux points de friction bloquent actuellement la conclusion d’un accord.
Le premier est l’accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs européens. Les Européens avaient promis un accord rapide sur la pêche afin d’apaiser leurs pêcheurs, qui craignent de ne plus avoir le même accès aux eaux britanniques, très poissonneuses. Mais l’inflexibilité des deux côtés de la Manche n’a pas permis de concilier des positions de départ aux antipodes : le statu quo dans l’accès à ces eaux du côté européen, un contrôle total avec des quotas négociés chaque année pour Londres.
En fait, alors que cette activité ne représente qu’une part négligeable de l’économie des 27 et du Royaume-Uni (en moyenne, les Européens pêchent, chaque année, pour 635 millions d’euros dans les eaux britanniques et les Britanniques pour 110 millions d’euros dans celles de l’UE), le sujet n’en reste pas moins explosif et très politique pour une poignée d’Etats membres (France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Irlande) et hautement symbolique pour Londres.
Les 27 ont convenu qu’ils vont devoir restituer au Royaume-Uni une partie de ce qu’ils capturent, chaque année, dans ses eaux, aussi bien sur les côtes qu’au large. Mais ils sont loin de s’entendre avec Londres sur la taille de cette restitution. Les deux parties sont également en désaccord sur la durée de la période de transition garantissant un statu quo de quelques années dans l’accès des bateaux européens aux eaux britanniques. Enfin, les Européens entendent lier tout accord sur la pêche à l’accord économique dans son ensemble, ce que le Royaume-Uni refuse.
Le deuxième point est la régulation de l’économie du Royaume-Uni. L’UE est prête à offrir à Londres un accord commercial inédit sans droits de douanes, ni quotas mais pas à laisser se développer à sa porte une économie dérégulée, qui la concurrencerait de manière déloyale. Pas question, par exemple, de voir le Royaume-Uni s’autoriser à polluer un peu plus, quand les producteurs du continent devraient respecter des normes environnementales strictes. Sur l’environnement, comme sur le droit du travail ou la transparence fiscale, Bruxelles a donc une demande : que les Britanniques s’engagent à ne pas les réduire.
Mais elle réclame aussi une « clause d’évolution » pour s’assurer d’une certaine convergence dans le temps. Parmi les éventualités, chaque partie pourrait suggérer des mises à niveau, qui pourraient ensuite être avalisées d’un commun accord.
L’UE va plus loin sur un sujet qui l’inquiète particulièrement : les aides d’Etat. Elle craint que le Royaume-Uni ne subventionne ses entreprises et son économie à tour de bras alors que les règles européennes sont très rigoureuses. Sur ce point, les demandes de l’UE sont encore plus restrictives. En cas de divergence, l’UE souhaite pouvoir recourir à des contre-mesures unilatérales et immédiates comme des droits de douane, avant même que le différend ait été tranché par une procédure d’arbitrage classique, ce que Londres rejette.
Quelle est la suite des événements ? Les négociations peuvent-elles connaître une prolongation et se dérouler en 2021 ?
Plutôt que de prendre acte de l’échec, la présidente de la Commission européenne et le premier ministre britannique ont annoncé la poursuite des discussions. Ainsi, la priorité est donnée à un accord à l’amiable.
Au-delà des discussions d’apparence technique du moment, la conclusion ou non d’un accord et le contenu de ce dernier détermineront l’ampleur des dommages infligés, notamment à l’emploi. Or, le choix entre « deal » et « no deal » dépend essentiellement d’options politiques. Un « no deal » représenterait un terrible échec. Il faut donc souhaiter un accord.
Si au 1er janvier 2020, le Royaume-Uni divorce de l’Union Européenne sans accord, quelles seront les principales conséquences pour les Français (résidents et non-résidents)?
Toutes les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne obéiront alors aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. A partir du 1er janvier 2021, outre les contrôles aux frontières et les procédures douanières inévitables, les taxes à l’importation seront également d’application, ce qui rendra les échanges commerciaux plus coûteux (augmentation des coûts).
En fait, pour bien apprécier les conséquences, il faut considérer que, plus la relation finale entre le Royaume-Uni et ses partenaires européens sera proche de celle de l’adhésion à l’UE, plus les coûts macroéconomiques du Brexit seront faibles. A l’inverse, entraver la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux augmentera les coûts du commerce et affectera les investissements, ce qui se traduira par une baisse du Produit intérieur brut (PIB) pour l’économie du Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, pour l’économie de l’UE.
Valéry Giscard d’Estaing, qui s’est éteint il y a quelques jours, considérait que « le départ des Britanniques serait plus douloureux pour eux que pour nous ». D’un point de vue économique, qu’en pensez-vous ? Quelles sont et seront les conséquences du Brexit ? Ont-elles été anticipées par le marché ?
Un no deal aurait des conséquences variables sur les économies, selon les secteurs.
Concernant le commerce, la facture pourrait s’élever à environ 3,5 milliards d’euros de pertes d’exportations pour l’Hexagone et, pour l’UE, le coût se chiffrerait à 33 milliards d’euros. L’application de droits de douane pourrait pâtir à l’industrie automobile, aux exportateurs français de vins et de spiritueux… Plus généralement, les 30 000 entreprises françaises qui exportent au Royaume-Uni – et a fortiori les 3 000 qui s’y sont installées – risquent de subir de lourdes pertes en cas de « no deal ».
Le Royaume-Uni est, plus généralement, le troisième client du secteur agricole français, qui a dégagé, en 2018 et 2019, un excédent d’environ 3 milliards d’euros en moyenne vis-à-vis du pays. Un montant cependant en baisse depuis 2016, année du référendum. Les pertes pour les secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alcool et des cigarettes seraient de l’ordre de 305 millions d’euros.
Concernant les transports aériens, selon l’Association internationale du transport aérien, une chute de 3 à 5 % du trafic à destination et en provenance du Royaume-Uni serait à prévoir en l’absence d’accord. Pour y remédier, certaines compagnies britanniques ont ouvert, depuis 2017, des filiales dans des Etats de l’UE afin d’assurer l’ensemble de leurs vols intra-européens ou vers des pays tiers.
Au total, selon certaines estimations, un « no deal » aurait un impact économique trois fois supérieur à celui de la pandémie de Covid-19.
Un Brexit sans accord augmenterait la volatilité des marchés financiers, d’autant plus que les événements risquent d’échapper à tout contrôle. L’impact direct serait un choc possible pour la livre sterling, les marchés du crédit et des actions britanniques ainsi qu’une période de stress pour l’indice FTSE. L’euro et les marchés européens en souffriraient également. L’impact à long terme est difficile à prévoir, mais une baisse des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre dans le but d’atténuer l’effet sur l’économie est probable.
Dans ce contexte, l’économie britannique serait probablement automatiquement plongée dans une récession. La gravité de la situation dépendrait, en grande partie, de l’application différente des tarifs. Certains économistes pensent que cela pourrait réduire le PIB de la Grande-Bretagne de 1,5% à 2% au cours des 12 premiers mois suivant la sortie du Royaume-Uni hors de l’UE. Pour l’Union européenne, l’impact serait négatif (0,5 à 0,7% du PIB), mais les Européens disposent d’une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour atténuer les effets de la chute du Royaume-Uni.
Au contraire, un accord même transitoire serait une bonne nouvelle pour les marchés, qui, actuellement, considèrent ce scénario comme l’un des plus probables.
Le Brexit aura-t-il des effets sur l’emploi au Royaume-Uni, et notamment l’emploi des Français expatriés ? Et sur les investisseurs ?
Selon une étude de l’Institut IWH (2019) se basant sur l’hypothèse d’un recul de 25% de la demande pour des produits européens au Royaume-Uni, ce seraient près de 50 000 emplois en France qui seraient menacés par un « no deal ».
Si un tel scénario se réalisait, le choc serait plus important pour le Royaume-Uni que pour les Vingt-Sept : une étude du cabinet Cambridge Econometrics (2018) avait estimé qu’au total, ce seraient environ 500 000 postes au Royaume-Uni qui seraient menacés par un « Brexit dur ».
Dans ces conditions, il est probable que certains expatriés pourraient rencontrer des difficultés dans leur activité, selon les secteurs. Quant aux investisseurs, des opportunités pourraient se faire jour en fonction du plan de relance qui sera envisagé.
Avez-vous autre chose à ajouter ?
L’UE a un certain avantage dans ces négociations. Elle sait que le Brexit ne va pas changer grand-chose à son fonctionnement interne alors que le Royaume-Uni est confronté à la tâche monumentale de reconstruire ses institutions.
Mais compte tenu de l’intérêt de l’UE pour un Royaume-Uni post-Brexit prospère, elle devrait faire le premier pas vers la sortie de l’impasse actuelle, en adoptant une posture plus conciliante sur le maintien de l’équivalent des régimes existants d’aides d’État et de règlement des différends.
En outre, l’UE doit en finir avec son intransigeance sur les droits de pêche, qui sont économiquement peu importants mais politiquement puissants au sein du Royaume-Uni, à l’heure où ce pays tente de faire preuve d’un certain degré de souveraineté.